|
|
|
|
|
| |
Révolution chantante
07/06/2006 23:52

Paavo Järvi, hier soir, après sa direction de la symphonie n°2 de Mahler – le final ! la première intervention des chœurs ! – était accompagné d’une trentaine de musiciens et choristes, qui avaient bien volontiers cédé à son invitation autour d’un bon repas. Un des choristes attira mon attention. Pendant le concert, il était déjà remarquable. Il était le plus grand, le plus fort, le plus blond. Sa voix était-elle la plus puissante ? Son allure impressionnante avait fait retourner plus d’une tête quand il était entré dans le restaurant. Cependant, c’était autre chose qui m’intriguait, sa main gauche était artificielle. La prothèse était parfaite, mais une certaine rigidité, une légère maladresse brusque, des reflets de lumière sur la « peau », faisaient se rendre à l’évidence dès que l’on y prêtait attention.
Le repas fut bien arrosé, bruyant et musical à la fois. Anton (il s’appelait Anton) parlait haut et fort, déclamait des poèmes d’Altenberg, et je voyais bien que Paavo riait beaucoup à ses plaisanteries. Je compris d’ailleurs quand le groupe se sépara, tard, la basilique aux toits bleus apaisant la nuit redevenue froide, et que nous partîmes tous les trois, qu’une réelle affection unissait ces deux hommes.
Pendant le trajet du retour à l’hôtel, à l’arrière du taxi, Paavo me parla de son ami, en français, langue que ne parle pas Anton. Ils ont grandi dans la même région d’Estonie, et se sont connus à Los Angeles où ils sont devenus amis. C’est une grande joie pour eux de se retrouver au hasard de leurs concerts respectifs.
« Il a participé activement à la Révolution chantante, ce qui est normal pour un choriste, s’amusa Paavo, et un jour, il fut emmené par des « bérets noirs » dans un hangar, où l’attendaient deux personnes cagoulées et des soldats armés. Apparemment, les OMON allaient s’occuper de lui. Effectivement, on l’a assis à une table, un des deux cagoulés lui maintint le bras pendant que l’autre lui sciait le poignet. Quand il revint à lui, les deux personnages se décagoulèrent et il reconnut ses parents. Sa mère pleurait, son père était livide, et disait « pardonne nous ». Les OMON abattirent alors ses parents et les laissèrent tous les trois dans une mare de sang. »
En tout cas, je n’ai pas trouvé ça très poli de parler devant lui dans une langue qu’il ne comprend pas.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Bleu comme neige
06/05/2006 09:13

La semaine dernière, quelques jours de ski sur les pentes du Cotopaxi, avec Antonio, un des fils de Luis Macas, Président de la CONAIE. Nous nous étions retrouvés à Chugchilán, seuls ; la femme d'Antonio ayant accouché il y a quelques mois, n'était pas venue. D'humeur très enjouée habituellement, mon compagnon semblait assez maussade. A la fin du séjour, dans la voiture qui nous ramenait à Quito, il m'avoua qu'il vivait un véritable cauchemar.
J'ai d'abord cru qu'il craignait pour son père ou pour sa propre sécurité, ou que la tâche de régénération du mouvement entreprise par son père et lui depuis plus d'un an l'avait étouffé.
Non, il s'agissait d'un drame bien plus intime, mais tout aussi difficile à vivre.
En effet, son dernier-né était atteint du syndrome de Bloom. Les médecins, pour déterminer le porteur, avaient demandé des analyses. Aucun des deux, ni sa femme, ni lui, n'était atteint. Mais, catastrophe, les tests avaient montré que l'enfant n'était pas d'Antonio.
Evidemment, afin de parer à un risque éventuel, le sang des deux enfants précédents du couple fut également analysé. L'exposition à la bromodéoxyuridine ne provoqua pas d'augmentation du taux d'échange entre les chromatides sœurs. Le test était donc négatif, ce qui, somme toute, était positif. Ce qui l'était moins, bien sûr, c'est qu'Antonio là non plus, n'était pas le père.
Arrivés à Quito, j'étais un peu gêné du tragique de ces confidences. Je suis allé saluer Miranda, malgré tout, et, au moment où je lui faisais la bise, à ma grande surprise, j'ai cru la voir me faire un clin d'œil.
|
Commentaire de adele (07/05/2006 09:37) :
..On peut rire de tout, mais à condition que tout le monde rit..
|
|
Commentaire de larry (21/05/2006 09:38) :
Pas d'accord, je préfère Desproges :
« On peut rire de tout, oui, mais pas avec n’importe qui. »
Ceci dit, en écrivant cet article, j'ai pensé, à tort apparemment,
qu'on verrait le côté absurde, le chagrin n'étant pas à sa place,
le couple étant plus préoccupé de la paternité que de la maladie de leur
enfant. Je n'ai pas été assez explicite, il semblerait.
|
|
Commentaire de Jo (05/06/2006 00:17) :
Bonjour,
Une faille de taille et d'amateur :
"pour déterminer le porteur,
avaient demandé des analyses"
est un non sens :
la transmission de la maladie de Bloom se fait selon le mode récessif
autosomique, il faut que les deux parents portent l'anomalie génétique
pour que l'enfant ait la maladie.
Donc les deux parents sont porteurs. Pourquoi les teste-t-on dans votre
récit ?
De meilleur goût et plus explicite sur le côté absurde recherché : il eût
fallu inventer une maladie ; comme le syndrome de Larico-gigantisme, par
exemple.
Par ailleurs, Desproges a réfléchi toute sa vie au point soulevé. (évoqué
dans des interviews espacées de plusieurs années).
Sa dernière réflexion était "On peut rire de tout, mais pas avec tout le
monde."
(et non pas "n'importe qui", veillez à être précis lorsque vous citez
avec guillemets)
(Notez également qu'Adèle n'est pas "n'importe qui").
Sinon, dans la vraie vie, les médecins sont prêts à mentir pour éviter ce
type de situation, ceci est une scène vécue :
Le généticien dit aux parents : "on va vérifier quel est le type de
mutations sur chacun d'entre vous, sachant qu'il arrive que des
mutations spontanées se produisent et qu'on ne retrouve pas chez les
deux parents la mutation patati patata..."
Votre texte est sauvé par une belle chute. (de neige, d'où le titre
?).
Bye,
|
|
Commentaire de Larry (08/06/2006 00:06) :
Merci pour ce commentaire. Cependant, s'il fallait rechercher les
failles, les approximations, les invraisemblances et les à-peu-près dans
mes textes, sans parler des mensonges ou des inventions, on n'en
finirait pas...
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Chat
27/04/2006 23:36
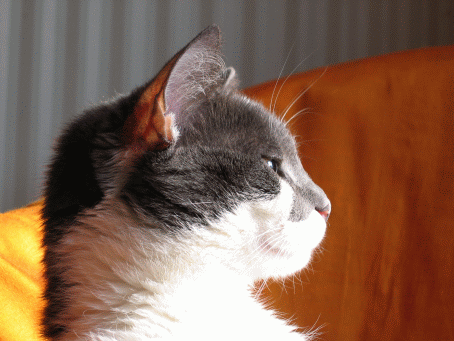
« J’ai toujours aimé peindre des portraits. Au début de mon séjour à New-York, je trouvais des modèles dans Central Park. Des gens désœuvrés, jeunes ou vieux, noirs ou blancs, hommes ou femmes. Un jour d’été, je repère une vieille dame, qui semblait très âgée, assise sur un banc au soleil, les yeux fermés. Je m’approche d’elle. Elle sursaute. Je lui demande si elle veut bien poser pour moi. Après une courte discussion, elle accepte.
Ainsi, quelques jours plus tard, nous nous retrouvons chez moi, dans la pièce qui me sert d’atelier, et encore d’autres jours après. Pendant les heures où nous fûmes ensemble, j’appris tout de sa vie, sauf la période qui semblait être la plus douloureuse, la fin de la guerre, après sa libération de Birkenau. De cette femme émanait à la fois un grand courage, une grande énergie, et aussi, bizarrement, comme un grand désespoir, une résignation, une douleur assumée, jamais dite. J’avais beaucoup de plaisir à l’écouter, et le soir venu, quand elle quittait mon appartement, je me sentais seule, triste, et pourtant soulagée.
Enfin, le tableau fût fini, et je ne revis plus Maude.
Ma mère, à cette époque-là, vivait en Israël, et de temps en temps, me rendait visite. Il se trouve qu’elle vint au printemps suivant, quand New-York sort avec exubérance de son hiver diabolique. Sitôt entrée dans la chambre d’amis, je l’entendis étouffer un cri. Je me précipitai et la vis, pâle, yeux ronds, souffle court, debout, fixant le portrait de Maude, que j’avais fixé au-dessus de son lit, croyant y voir une vague ressemblance avec ma mère.
Entre deux sanglots, et de longs moments de silence, elle me dit que cette femme ressemblait comme deux gouttes d’eau à sa mère, qu’à la sortie des camps, elle ne l’avait pas trouvée, l’avait toujours cru morte, que ce n’était pas possible, comment aurait-elle pu atterrir à New-York, qu’il fallait aller trouver cette femme, que, non, ça n’était pas une bonne idée, si, sais-tu où elle habite… bref, une heure après, nous sonnions à la porte d’une petite maison coincée entre deux gigantesques immeubles. Maude vint nous ouvrir, un chat dans les bras, un bon gros chat gris, persan, qui souriait. Et comme son chat, elle souriait… »
Cette histoire, Nathalie Munk, qui travaille toujours à Manhattan, me l’a racontée chez elle, la semaine dernière, et en me montrant le tableau, elle a conclu : « Comme dit le proverbe chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. »
| |
|
|
|
|
|
|
| |
La Bocca della Verità
03/04/2006 21:48

Lorsqu’on met sa main dans la Bouche de la Vérité, on ne peut la ressortir que si 1'on n’a jamais menti. Sinon, la bouche la mange.
Après la mort d’Ali Farka Touré, qui a affecté beaucoup de monde sur cette terre, il me revient une histoire qu’il aimait à raconter, au détour d’une conversation, le soir sur la terrasse de sa maison de Bamako :
Pas très loin du fleuve Niger entre Sibila et Dolonguebougou, un jeune homme avait dit du mal d’une jeune fille du village voisin. Le jeune homme, Mogola, avait raconté que la jeune fille était enceinte de lui. La jeune fille, malgré ses protestations, avait alors été punie par les siens. Ali racontait souvent cette histoire, mais ne précisait jamais la punition ; cependant on ne doutait pas qu’elle fut horrible et terrible. Mogola vieillit, alla s’installer à Ségou, où il vécut de petits boulots dans des garages. Il prit femmes. Au cours d’une soirée après concert qu’Ali affectionnait tant, où il rencontrait son public, une des femmes lui raconta l’histoire de la jeune fille suppliciée. Mogola lui avait avoué avoir menti, qu’il avait tout inventé parce que la jeune fille s’était refusée à lui. Il n’avait pas osé se dédire par peur des représailles.
Mogola, alors âgé d’une trentaine d’années, vit au fil des jours les doigts de sa main droite bleuir, se raidir, se paralyser. Très vite, sa main entière fut invalide, ce qui lui interdit tout travail. Il ne put bientôt plus nourrir sa famille. Peu de temps passa et Mogola se noya dans le Niger.
Ali expliquait qu’il avait demandé à Toumani Diabaté, le koriste vituose, d’intercéder auprès des génies pour qu’ils inoculent à distance le korti, ce poison mortel et, dans un grand rire, il s’esclaffait : « La vérité lui a mangé sa main ! »
|
Commentaire de music_photo_design (03/04/2006 21:55) :
Bonne soirée et bonne Semaine a toi !!! a très bientôt…
Passe sur mon blog si le cœur t’en dit…
Bisous amicaux
Florence
http://www.vip-blog.com/vip/blogs/music_photo_design.html
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Hiver
09/03/2006 14:16

L’hiver s’éloigne, le printemps approche. Malgré le froid, la neige, on sent bien que le printemps fait le forcing et qu’il va gagner. Sans doute les jours qui allongent. Et ça, effet de serre ou pas, les jours rallongent au printemps, et c’est pas près de s’arrêter. Bref, la semaine dernière, en préparant le salon du livre avec Guillaume C. l’auteur de « Les pères de famille ne portent pas de robe », nous avions bien cette sensation, et Guillaume m’a raconté l’histoire suivante :.
« Nous revenions d’une visite familiale par l’autoroute A6, ma femme, notre fils et moi. La circulation était assez dense. On était un dimanche en fin d’après-midi, un dimanche de mars, justement. Le temps était un peu gris, pas trop, A hauteur d’Auxerre, la voiture se mit à fumer et à tousser, ce qui est assez fréquent quand on fume. Par chance, une aire d’autoroute avec une station service, telle une oasis, apparut au bout d’une légère descente. La voiture male en point nous y emmena malgré tout. Le verdict du mécanicien (?) tomba (oui, comme un couperet) : « Joint de culasse, le moteur est foutu. Vous avez roulé sans huile »
Dix-huit heures, sur une aire d’autoroute, des bagages dans le coffre, une voiture « morte », un petit que tout ça inquiète, des parents qui font semblant de ne pas s’inquiéter, bref, on avait l’air perdus, en tout cas, suffisamment pour qu’un couple de personnes âgées, la retraite, et leur fille (enfin, on a supposé), la quarantaine, nous prennent en pitié, et nous demandent : « Vous allez où, on peut peut-être vous rapprocher ? »
Sur le chemin de la maison, ils ont insisté pour nous ramener jusque chez nous, malgré le détour conséquent. On était contents d’avoir rencontré des gens aussi serviables, ce dimanche maussade finissait bien, somme toute. Leur fille était institutrice, elles avaient fréquenté la même école, mais pas en même temps, avec ma femme. Lui était ethnologue en retraite, mais il continuait ses recherches en dehors de toute structure, et sa femme, ancienne directrice d’école, se passionnait pour la reliure, ce qui nous avait fait un point commun. Le trajet d’Auxerre à la maison fut un délice. On était un peu serrés à quatre derrière, mais le minot, sur les genoux, s’était tenu bien tranquille. Je crois même qu’il avait dormi un bon moment.
Arrivés devant notre porte, ils n’ont jamais voulu rentrer, mais on a réussi à leur arracher leurs coordonnées, adresses des parents et téléphone de l’institutrice. Dès le lendemain, une bonne boîte de chocolats leur était envoyée. Une dizaine de jours après, notre boîte de chocolats nous revint avec la mention DCD. J’appelai aussitôt leur fille qui m’apprit que deux ou trois kilomètres après nous avoir quittés, malgré un brusque coup de frein, ils s’étaient encastrés sous la benne d’un semi-remorque qui reculait en travers de la chaussée sans les voir, et que ses parents étaient morts sur le coup.
Evidemment, si on avait mis de l’huile dans notre putain de bagnole, ils seraient toujours là. Comme quoi, le printemps, l’hiver, tout ça…»
Guillaume ajouta que les chocolats étaient délicieux.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Pauvre con
13/02/2006 22:50

Cette semaine de ski, avec mon ami d'enfance, Arno, m'a bien reposé. Nous en avions besoin, lui et moi. A l'aller et au retour, nous sommes passé devant "LE" lac. Evidemment, ce lac est notre enfance, notre enfance pré-pubère, avant que les démangeaisons de notre libido ne nous préoccupent plus que le reste.
A cet âge-là, hiver comme été, nous partions à vélo rejoindre "notre" lac. Nous restions assis, très silencieux, jusqu'au coucher complet du soleil, heureux, repus. Le lac changeait ses couleurs, le reflet de son écrin de montagnes disparaissant peu à peu, et nous n'avions pas besoin de nous regarder pour sentir l'émotion de l'autre.
Et, au retour, quand nous nous sommes à nouveau assis devant le paysage de notre enfance, nous avons évoqué l'autre con qui, un jour, nous avait dit que cette vallée lui semblait triste, moche, désespérée "quel malheur d'avoir passé votre enfance dans ce trou !" Un simple sourire amusé de notre part l'avait remis à sa place.
|
Commentaire de Nano (16/02/2006 17:48) :
Je l'ai reconnu, c'est le lac des Hopiteaux
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Voyage
29/01/2006 22:22
"Le train est entré en gare. Je n'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine. Je l'ai embrassée Molly avec tout ce que j'avais encore de courage dans la carcasse. J'avais de la peine, de la vraie, pour une fois, pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes.
C'est peut-être ça, qu'on cherche à travers la vie, rien que cela, le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir."
Voyage au bout de la nuit.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Madeleine
23/01/2006 23:19

De mes petites-filles, l'aînée, Amande, travaille au Comité 21. Elle a organisé un stage de sensibilisation interne ce week-end au château de Trilbardou. Evidemment, j'y suis passé, et le soir, tard, à l'heure où tout le mode dormait, j'ai montré à Amande une petite cachette sur le côté droit de la grande cheminée. On m'avait prévenu, il vaut mieux être deux pour l'ouvrir, tirer sur une moulure, et appuyer sur un des yeux du lion : une porte étroite s'ouvre lentement sur un petit recoin.
Amande, par bonheur, fume, et ses allumettes nous permettent d'éclairer l'espace devant nous.
En vrac, et par morceaux interrompus par le grattage de chaque allumette, notre regard découvrit un pot à lait, cabossé, dont le vide était à peine masqué d'un couvercle retenu par une chaîne, un bol vert, le quatre heures - chocolat fumant avec tartines beurrées - me revint immédiatement en mémoire, des cyclistes en plomb peint, le maillot rouge et blanc de Charlie Gaul, une petite Dinky Toys, une Dauphine, je crois, un peigne en plastique brun, et encore plus...
Amande, intelligente, sensible, a détourné son regard, et m'a dit : "On va aller se coucher, Pépé !" Dans ma chambre, j'ai été long à trouver le sommeil.
|
Commentaire de lecoda (27/01/2006 18:54) :
Sur le peigne, une mêche de cheveux : blonds? chatains ? bruns ? noirs?
|
 Commentaire de Larry (27/01/2006 19:10) : Commentaire de Larry (27/01/2006 19:10) :
Lettre de colonie de vacances :
Chers Papa et Maman,
Je m'amuse bien, je mange bien, je dors bien. J'ai perdu mon
peigne.
Je vous embrasse.
Larry
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ventre
15/01/2006 22:16

Monsieur Jaswant Singh, ministre des affaires étrangères de ce grand pays qu'est l'Inde, et auquel on ne pense pas assez dans les ambitions géopolitiques actuelles, me disait lors de sa visite parisienne, il y a un peu plus de quatre ans : "Cher Larry, figurez-vous que Sharon est beaucoup plus sensible qu'on ne croit. Je l'ai vu pleurer à l'évocation de Sabra et Chatila, il n'y a pas huit jours !"
L'état de santé du premier ministre israélien me ramène cette petite confidence en mémoire. Le remords, est-ce la réalité de la vieillesse ? Est-ce la condition humaine ou la "divine nature des choses" comme dit Marguerite Yourcenar ?
Peut-être Sharon, quand il sort de son coma, se récite t'il ce passage d' Emile Nelligan : "Qu'il est doux de mourir quand notre âme s'afflige, Quand nous pèse le temps tel qu'un cuisant remords, Que le désespoir ou qu'un noir penser l'exige..." Il est vrai que ces vers viennent d'un homme ayant passé 42 ans de sa vie dans un asile, et non pas au pouvoir.
Sinon, un petit régime s'impose, mon cher Jaswant !
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Seule
18/12/2005 13:48

La solitude, ça commence quand on est obligé de sortir dans le froid pour fumer sa cigarette, seule, sans personne à qui parler, avec juste cette chaleur qui pénètre la gorge, cette douce chaleur, cette fumée additionnée de buée, qu'on exhale avec plaisir. Enfin, pour certains, ça commence comme çà.
Avant-hier, dans les locaux rénovés du New York Times, j'ai croisé John Leland, qui m'a fait lire son article sur les jeux vidéos, et de fil en anguille (comme dit Breton), nous avons évoqué les terreurs de nos enfances : "Enfant, j'ai cru, au détour d'un malentendu, que mes parents m'avaient abandonné. Je me souviens de la panique qui m'a envahi, comme si c'était il y a deux minutes." m'a t'il dit.
Dans "Language and Solitude : Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma", Ernest Gellner amalgame bizarrement individualisme et solitude : "Crusoe's isolation saves him from following a multitude to commit folly."
John Leland en a beaucoup ri...
| |
|
|
|
|